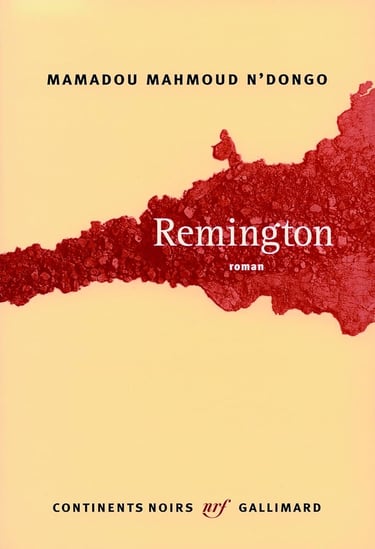PRESSE
REMINGTON


Éloge de la vacuité
par Sami Tchak
Avant même de les lire, on reconnaît les livres de Mamadou Mahmoud N’Dongo à cette mise en page singulière, à cette composition presque musicale : des séquences allant de quelques lignes à une page ou deux. La première impression, c’est qu’ainsi organisé, le texte nous accorde beaucoup d’espaces de détente, un certain confort de lecture.
La vérité, c’est que cette composition répond rigoureusement à une démarche esthétique : les univers de Mamadou Mahmoud N’Dongo se présentent comme des miroirs brisés qui nous renvoient des réalités constamment fragmentées, déconstruites, qu’il nous faut recomposer pour obtenir, surtout avec le nouveau roman, Remington, sorti le 30 août aux Éditions Gallimard, une prenante symphonie urbaine. Sur 385 pages, découpé en 3 parties, « Autofiction(s) », « Saturne », « Décompte du temps présent », et fait de 115 séquences, dont chacune porte comme titre celui d’une chanson, Remington est surtout une peinture pleine d’humour d’une époque saisie à travers la relation amoureuse, les identités sexuelles, l’art, etc. L’on peut résumer ce texte avec ces paroles mises dans la bouche du héros narrateur Miguel Juan Manuel : « J’étais devenu le chroniqueur de ma propre déchéance… Mes portraits, mes papiers, mes articles étaient un développement itératif de moi et de moi-même au-devant de la Vie, de l’Amour et de l’Art… Dans de courts chapitres, comme autant de récits de vie, de récits de soi, je ‘‘chronique’’ les ambivalences d’une génération, ses incertitudes, ses doutes. » (p. 90).
Mais, l’on y perçoit surtout le rire à la fois caustique, amusé et empathique de l’auteur qui, prenant comme prétexte l’hebdomadaire Remington, ayant pour objet l’actualité culturelle et la société, peint une certaine médiocrité qui n’est pas tant le résultat des incapacités individuelles que le produit d’un climat général, d’une époque, une certaine démission devant toute véritable ambition… Miguel le dit avec sur ton désabusé : « Plus le monde nous était rendu accessible et moins nous voulions y accéder, comme si on pressentait une blessure narcissique ; nous ne voulions pas d’un monde compliqué, mais binaire : ouvrir ou fermer la fenêtre, tout devait être accessible et simplifié, le monde devait être un grand livre dont on pouvait tourner les pages, sans avoir à les lire, nous n’avions plus besoin d’un manuel, nous n’avions plus besoin d’autres récits de vies, d’être encombrés d’autres histoires ; la mienne me suffisait. » (p. 178), ou, à la page suivante : « Nous étions des sortes d’Oblomov possédant des iPhone pour communiquer, des iPad pour lire les actualités, et des Mac-Book Air, pour devenir les scribes de notre vacuité. » Cette vacuité, le héros nous la fait d’autant mieux sentir à travers les hommes et les femmes, collèges, locataires, partenaires sexuelles, etc., que lui-même, tout en y contribuant, s’en extrait grâce d’une part à sa propre histoire familiale assez riche, et d’autre part avec son acuité, ses réflexions qui donnent sa densité à l’ordinaire, au trivial. Miguel Juan Manuel est le petit-fils d’un peintre, militant républicain qui avait combattu le fascisme de Franco, d’un père psychiatre, d’une mère qui avait fini folle sous le poids de la dictature raffinée de son mari. Il avait aussi un frère homosexuel. Grâce à l’histoire de chaque individu de ce cercle familial, narrée par bribes, nous nous élevons au-dessus des nombreuses séquences de vies dominées par le sexe, la drogue, l’alcool, les lieux mêmes de toutes les réflexions, un peu comme dans le monde de Sade où c’est du territoire le plus factuel de la génitalité que surgit une philosophie iconoclaste.
Mamadou Mahmoud N’Dongo réussit, avec art, à nous captiver par une certaine légèreté, beaucoup d’humour, pour finalement nous amener à nous confronter à nous-mêmes chaque fois qu’au détour d’une page, nous nous retrouvons en face de nos propres doutes, de nos propres lâchetés, de nos propres médiocrités, devant notre propre façon d’être au monde, d’être dans ce monde de nivellement forcément par le bas.
Remington n’est pas un roman à résumer, en parler renvoie plus à une tentative d’en communiquer l’atmosphère. Le véritable voyage attend toujours le lecteur, sur ces sentiers en constantes cassures, car la vie elle-même, bien qu’elle semble un chemin assez droit, « on naît, on souffre, on meurt », nous force toujours à des détours. C’est sur les détours de Remington qu’il faudra alors s’engager.
Un regret toutefois : Octave, le témoin de toutes ces scènes de vie, celui qui les a partagées en partie, Octave nous a privés de ses propres observations, de ses propres réflexions, de ses propres doutes, de ses propres fantasmes. Pourtant, au cœur de cette humanité qui semble à la dérive, mais d’une dérive jouissive, l’avis d’un chat nous eût été assez précieux pour nous permettre de mieux nous comprendre nous-mêmes.